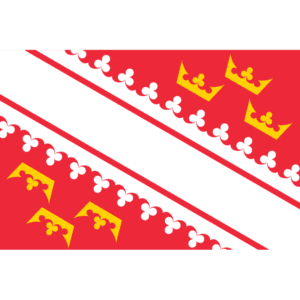André Weckmann est pour beaucoup le plus grand auteur alsacien de la seconde moitié du XXe siècle… et est largement méconnu aujourd’hui. (Re)découvrons son œuvre à l’occasion du 100ème anniversaire de sa naissance.
Cet article est une synthèse du dossier de 22 pages consacré à André Weckmann dans le numéro de décembre 2024 de la revue Land un Sproch. Alsace.News remercie la revue et ses auteurs, notamment Armand Peter et Jean-Marie Woehrling, pour le droit de reproduction et d’adaptation de ce dossier pour le présent article.
Publiée par l’association Culture et Bilinguisme – René Schickele Gesellschaft, Land un Sproch est la revue bilingue trimestrielle de référence de la culture alsacienne.
> Pour la découvrir à travers d’anciens numéros, c’est ICI
> Pour s’abonner en ligne c’est ICI

André Weckmann (1924-2012) est né à Steinbourg le 30 novembre 1924 d’un père alsacien et d’une mère lorraine. Il fait des études secondaires à Strasbourg au collège Saint Étienne. Dès 1940, il écrit ses premiers poèmes « patriotiques » et antinazis en français et en dialecte. Incorporé de force dans la Wehrmacht en février 1943, il est blessé sur le front russe près de Fastov en Ukraine. Il déserte en septembre 1944 et se cache dans la maison familiale jusqu’à la Libération (22 novembre 1944).
Il passe ensuite son bac et entreprend des études d’allemand à l’Université de Strasbourg. Il est nommé animateur de cours de 1954 à 1960 puis professeur d’allemand au lycée de Neudorf à Strasbourg, de 1961 à 1989.
Après de premiers textes dans la revue « Élan » du FEC, André Weckmann publie son premier ouvrage en français Les Nuits de Fastov (1968 – voir ci-dessous) et son premier livre en allemand Sechs Briefe aus Berlin (1969). Ses poèmes paraissent depuis 1962 dans la « Petite Anthologie de la poésie dialectale » éditée par l’association Weckerlin. Dès 1972, le combat culturel rejoint les luttes écologiques. L’écrivain et poète publie six ouvrages en français, dialecte ou allemand standard entre 1975 et 1978 et reçoit le prestigieux prix Hebel décerné en Allemagne (1976). Mais « l’euphorie militante » ne suffit pas pour reconquérir le terrain linguistique perdu. Avec Eugène Philipps, il lance un projet éducatif et culturel pour l’Alsace et mène un travail acharné au service du bilinguisme, travail qui ne sera malheureusement pas poursuivi par l’Éducation nationale.
Depuis 1980, il publie plus de trente ouvrages – romans, récits, recueils de poèmes, essais – dans les trois langues ainsi que de nombreux articles dans des journaux et revues. C’est le grand retour à l’allemand « nourri de sève alsacienne », c’est l’explosion poétique en dialecte et la prise en charge de la parole liturgique. C’est le plaidoyer pour le bilinguisme, la création d’une zone bilingue franco-allemande, modèle pour l’Europe, mais aussi l’hymne à la vie et à l’amour. André Weckmann meurt le 29 juillet 2012 à Strasbourg.
La guerre, vécue en allemand, racontée en français

1943 « Nous avons 18 ans, frères, et nous sommes damnés ». Ce n’est que 25 ans plus tard, en 1968, qu’André Weckmann publie un récit de la guerre qu’il a vécue, Les Nuits de Fastov. Le récit est écrit en français. Sans doute ne pouvait-il pas l’écrire autrement, il ne pouvait l’écrire en allemand, dans la langue forcée de l’oppresseur. Il se souvient : le convoi, de Calais jusqu’au fond de la Prusse, la traversée de la Pologne, l’arrêt à Varsovie. Des camions les emmenèrent au front, devant Fastov en Ukraine.
Quel est le français du récit Les Nuits de Fastov ? C’est une création littéraire, c’est un français original, baroque, une langue inouïe, nerveuse, impétueuse et incantatoire, triviale, crue par endroits, et lyrique, poétique, à d’autres. Plus jamais, dans ses romans ultérieurs, André Weckmann n’écrira un français aussi contrasté, aussi ornementé, aussi hétéroclite, aussi dingue. Temps présent et temps passés s’enchaînent dans un même flux verbal à travers les épisodes de la guerre, les uns dramatiques, d’autres plats, d’autres grotesques:
« Rien à faire qu’attendre. Nous pûmes donc à loisir fumer nos pipes… La nuit, pour convaincre les autorités de notre loyalisme, nous nous appliquâmes à tirailler sur des chats et des ombres. Mais l’adjudant, soupçonneux, finit par mettre de l’ordre dans nos nuits artésiennes. Ce fut à cette époque que vinrent les premiers brouillards d’automne et quinze jours plus tard nous embarquâmes pour l’Est. »
« Ce grand fromage de Hollande qui cherche son port en louvoyant au milieu d’un milliard d’imbéciles qui se tirent dessus en brandissant des drapeaux ? – Moi…– Oui, je sais. Moi aussi. Paris, Jeanne d’Arc, le père Hugo, le Sacré-Cœur-de-Montmartre-sauvez-sauvez- la-France, puis Viviane Romance, la Mistinguett et Joffre-Foch-et- Clemenceau. La France, quoi. De Gaulle à Londres, l’oncle à Paris, Juliette en Artois. Le gauleiter à Strasbourg et nous en plein dans la merde devant Kiev en Ukraine. On ne s’en sort plus. Tant pis. Faut roupiller maintenant, les enfants.»
André Weckmann, génie de la poésie
André Weckmann a semé des centaines de poèmes en dialecte qui constituent aujourd’hui l’une des œuvres les plus inventives du XXe siècle, sans doute l’une des œuvres majeures de la littérature alsacienne depuis le Moyen Âge. Les titres comme les poèmes aiment jouer avec les mots : Schang d’sunn schint schun lang (1975), Ixidigar (« Ich hab di gern » – 2002) ou Haxschissdrumerum (1976).

En tout vingt recueils en dialecte et deux en allemand. Cet ensemble est repris, introduit et commenté par Peter André Bloch, auteur de la formidable édition complète de l’oeuvre poétique d’André Weckmann éditée en sept volumes entre 2000 et 2007, en tout plus de 1800 pages avec entretiens, textes, poèmes en dialecte et leurs traductions allemande et française par le poète.
La poésie dialectale d’André Weckmann illustre tous les thèmes de la vie et les grands problèmes de la société d’aujourd’hui : les conflits, la vie quotidienne, les conditions de travail, l‘aliénation, la misère culturelle, le totalitarisme, la crise écologique.
« … D’hammer uns ins flaisch gewachse
uf de gsichter stiffi faxe
wiss de blick un wit d’klamotte :
uns wurd noch de dood verbotte. »
Les marteaux ancrés dans les chairs
Des grimaces figées sur les gueules
Des regards trop blancs, des frusques trop larges :
Nous laissera-t-on le droit de crever?
(Proletarier in Weckerlin, 1967)
André Weckmann met aussi son talent au service du spirituel, pour reformuler de manière personnelle le message chrétien comme dans le poème suivant dédié à Saint François d’Assise :
…gschosse sen
wie de Franz
un zit han
fer anderi
alli zit
alli lieb
un e
gott
su gschosse
wie ar
…être fou
comme ce François
et avoir du temps
pour les autres
tout le temps
et tout l’amour
et un
dieu
aussi fou
que lui
Zitlang nooch Assisi, extrait, in Haxschissdrumerum, 1976
Élan écologiste et culture alémanique

«Que serais-je devenu, dit André Weckmann, s’il n’y avait eu Mai 68 puis cet appel de Marckolsheim – contre un projet d’usine de plomb en 1974 ndlr – qui alluma notre première révolte écologique?» Juste après, un projet de centrale nucléaire côté allemand à Wyhl provoque l’occupation du terrain en 1975 par une « internationale » alsaco-bado-suisse.
André Weckmann alimente les luttes en les nourrissant de récits et de ses poèmes en dialecte souvent mis en musique par des chanteurs tel René Eglès.
Rhingold (1975)
… Es spalte drej herre am Rhin
met goldischi axe karne atom
de hauklotz esch min land
es hucke drej herre am Rhin
wann kejje mr se nin ?
… Trois messieurs au bord du Rhin fissionnent
des noyaux d’atome avec des haches en or
le billot, c’est mon pays
Trois messieurs sont assis au bord du Rhin
quand les y jetterons nous ?
Extrait du recueil en dialecte Schang d’sunn schint schun lang (1975).
En 1974, André Weckmann est l’un des fondateurs d’un Front Culturel Alsacien qui défend la sauvegarde de la culture et de la langue régionale et condamne « un libéralisme sauvage qui détruit nos paysages urbains et ruraux». Par la suite, il participe à l’organisation de plusieurs grandes manifestations dont la fondation en 1976 de l’Internationale alémanique qui regroupe les poètes dialectaux de part et d’autre du Rhin supérieur porteurs d’une prise de conscience alémanique apparue d’abord dans les luttes écologiques.
Ce grand élan ne durera pas, dans les années 80, les Verts se regroupent au sein d’un mouvement politique national et se détournent. À l’exception de quelques militants «écoloalsaco» : André Weckmann et ses amis resteront fidèles à leur engagement.
L’engagement d’André Weckmann pour l’enseignement de la langue régionale
Des initiatives pédagogiques mettant en valeur la complémentarité du dialecte et de l’allemand standard, un dialogue exigeant et souvent houleux avec le recteur Deyon, l’appui à l’enseignement bilingue paritaire, etc. ; André Weckmann a été un enseignant et un auteur engagé.
En 1979, il dénonce publiquement le recul de l’enseignement de l‘allemand dans les collèges et lance un « Appel des poètes, écrivains, chanteurs et militants culturels aux élus alsaciens » pour un statut officiel de la langue régionale. En 1981, il fait partie du groupe d’enseignants qui entourent le recteur Deyon et le conseillent pour la conception des circulaires qui doivent dynamiser l’enseignement de l’allemand. Il fait partie de ceux qui convainquent le recteur Deyon de définir la langue régionale comme incluant les dialectes et l’allemand, et insistent pour une meilleure prise en compte du dialecte en maternelle et primaire.
« Sans dialecte vivant, pas de bilinguisme populaire français-allemand. Sans dialecte, l’allemand n’aurait plus aucun ancrage social et culturel en Alsace. L’accès au bilinguisme serait réservé à une élite ».
Il faut donc redonner une consistance au dialecte. André Weckmann propose de renforcer les compétences des élèves en dialecte, puis de réaliser le passage « naturel » du dialecte à l’allemand standard en opérant un va-et-vient entre les deux formes pour que les élèves reprennent conscience que c’est une même langue.

Pour cela, il met au point une expérience « Im Zwurwelland » qui s’adresse aux classes de 6e et 5e. Le recteur Deyon donne son accord pour mettre en oeuvre l’expérience Zwurwelland dans quelques dizaines de classes.
Les débuts sont euphoriques, mais le climat change après 1985, le recteur est réticent pour de nouvelles avancées. Néanmoins à partir de 1987, André Weckmann est chargé de la rédaction d’un nouveau cours d’allemand pour dialectophones des classes de 6e et 5e. Il propose d’étendre cette méthode aux 4e et 3e. Mais il est de moins en moins soutenu par le rectorat et finalement les heures « Im Zwurwelland » sont supprimées au moment de son départ à la retraite en 1989. Ses efforts pour un renouveau de la pédagogie de l’enseignement de la langue régionale seront restés largement vains.
Que nous a légué André Weckmann ? Une oeuvre foisonnante, riche et complexe, une vie faite de changement et d’apaisement, toujours passionnée, au service d’une Alsace debout, ouverte, solidaire, fraternelle, fière de sa langue régionale, sa culture, son histoire.