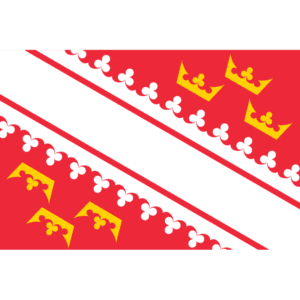Et si ce n’était pas le climat ? Frédéric Gruet, ediSens, 168 pages, 19,90€
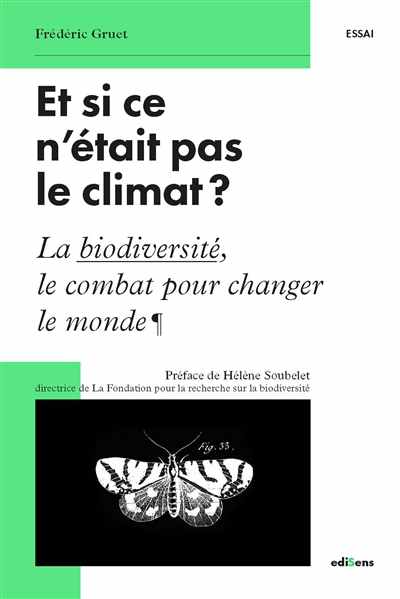
Le sous-titre apporte la réponse : La biodiversité, le combat pour changer le monde. Pour Frédéric Gruet, responsable biodiversité chez les Écologistes (EELV) et haut-fonctionnaire établi à Strasbourg, un combat peut en cacher un autre : la transition climatique est au cœur des débats, la biodiversité beaucoup moins.
À tort. Car la perte de biodiversité, induite par un changement climatique trop rapide et la surexploitation des sols, nous menace directement : production alimentaire en baisse, santé publique affectée par les pesticides, épidémies plus fréquentes, voilà ce qui nous attend si nous ne réagissons pas. Et les premiers affectés sont les plus fragiles socialement, d’où un accroissement des inégalités. Pas de catastrophisme simpliste dans cet ouvrage, mais des raisonnements et démonstrations qui s’appuient sur de nombreuses études scientifiques. Et une conviction : il faut d’urgence changer notre vision, d’un monde anthropocentrique (seuls comptent les besoins humains) à un monde plus respectueux du vivant (ndlr – on pense ici au Dr Schweitzer et à sa philosophique « Ehrfurcht vor dem Leben »). On appréciera en particulier le passage où Frédéric Gruet plaide pour laisser les enfants jouer plus librement dehors et ainsi explorer le monde.
Alors que faire ? Les milieux écologiques et leur biodiversité varient de territoire en territoire. C’est trop complexe pour être géré directement par un État central, il faut le faire au niveau des territoires concernés, c’est là qu’est la connaissance nécessaire. Frédéric Gruet cite en exemple le mot alsacien « Ried », lequel décrit une réalité alsacienne mieux que sa traduction française générique « prairie humide » : l’alsacien au service de la biodiversité, nous ne pouvons qu’apprécier ! Et il remet en cause les grandes régions et la métropolisation « pensées sur le principe erroné que plus c’est grand, plus c’est efficace. L’écologie se gère au niveau des villes et des régions, en remodelant ces dernières en « biorégions » (il en distingue une vingtaine en France, dont l’Alsace) auxquelles il faudra transférer compétences et financements. Tout en en renforçant la structure démocratique avec 3 assemblées complémentaires : une assemblée de scientifiques pour l’expertise ; une assemblée élue qui élaborerait des textes ; et, plutôt que des référendums à la suisse, une assemblée de citoyens tirés au sort et chargés d’approuver ou de rejeter, mais sans pouvoir les amender, les textes proposés.
Globalement, il faudra aussi changer le droit et les règles économiques pour arrêter de subventionner les comportements prédateurs et valoriser la gestion durable avec des « paiements pour services écosystémiques ». Frédéric Gruet est par contre sceptique sur les solutions à base de technologie et leur inverse, la décroissance. Et comment financer les milliers de milliards de dollars nécessaires à l’échelle de la planète d’ici 2050 ? Frédéric Gruet juge que créer des « crédits biodiversité » (sur l’exemple des « crédits carbone » négociables sur le marché) ne fonctionnera pas et plaide pour une création de monnaie par les banques centrales, comme on l’a fait après la crise des subprimes en 2008 pour soutenir l’économie, mais de façon plus ciblée.
Ce livre balaie large, arbore de vastes ambitions et argumente de façon convaincante. A ne pas manquer pour tous ceux qui s’interrogent sur les problèmes de survie de notre planète !
La République à l’épreuve de la démocratie, Pierre Klein, I.D. L’Édition, 150 pages, 28€ en librairie (mais déjà épuisé ?) et disponible gratuitement (PDF) en ligne sur le site de l’ICA
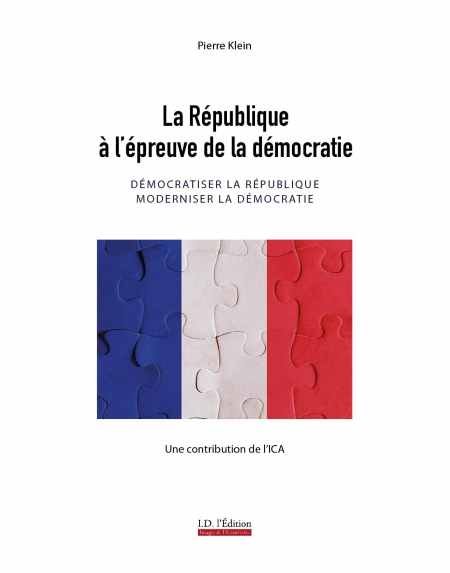
Les livres de Pierre Klein sont toujours des ouvrages de référence : solidement documentés, synthétiques, ils appuient les convictions de leur auteur pour le bilinguisme et pour l’Alsace. Ce dernier ouvrage peut-être encore plus que les autres car sa portée dépasse la seule Alsace.
La première moitié (82 pages) décrit les institutions démocratiques chez nos principaux voisins (Allemagne, Suisse, mais aussi Italie, Royaume-Uni, Belgique et Espagne) : pouvoir central, pouvoirs régionaux, pouvoir législatif, structure des impôts, etc. Les 40 pages suivantes reviennent sur la France, la comparent aux pays précédents et établit un diagnostic sans concession. Et en troisième partie, Pierre Klein récapitule ce qu’il en est en Alsace et surtout ce qu’il faudrait faire pour continuer à exister : redécouvrir/reconquérir son identité (bilinguisme inclus bien sûr), changer la répartition des pouvoirs entre État et région.
Le sondage de l’été des partis régionalistes de France (fédérés dans R&PS) a montré (enfin) une prise de conscience dans tout le pays des défauts d’un mode de gouvernement exclusivement parisien. Ce petit livre est un indispensable pour penser la suite, à l’échelle de la France aussi bien qu’à celle de l’Alsace.
Le vieux, la méchante et les autres, Pierre Kretz, La Nuée bleue, 18€
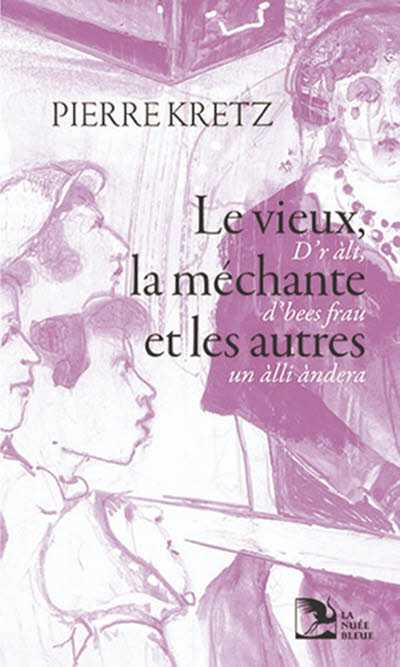
On vous avait déjà parlé de Sepp et de sa vaine attente (Ich wàrt ùf de Theo). Le voici qui revient dans une réédition bilingue français-alsacien en compagnie de son aînée Thérèse, l’héroïne de Ich ben e beesi Frau. Ces deux courts textes du dramaturge Pierre Kretz partagent la même structure narrative : une vieille personne, alsacienne jusqu’au bout des ongles, médite sur sa vie marquée par les malheurs et que rien ne viendra racheter.
C’est la particularité de ces deux monologues sombres et magnifiques : la violence du désespoir qui s’exprime, sans fard. Ich ben e beesi Frau en particulier n’est pas que la dénonciation du patriarcat rural ni même une histoire de vengeance comme La Visite de la vieille dame de Friedrich Dürrenmatt (explicitement référencée dans le texte), c’est un cri de désespoir, à l’égal du Woyzek de Georg Büchner (lui aussi écrit à Strasbourg !) ou, version blues, du classique Hey Joe popularisé par Jimi Hendrix. A lire absolument.
Nous les expulsés d’Alsace-Lorraine, 1918-1922, Jean-Louis Spieser, Éditions Yoran embanner, 640 pages, 24€
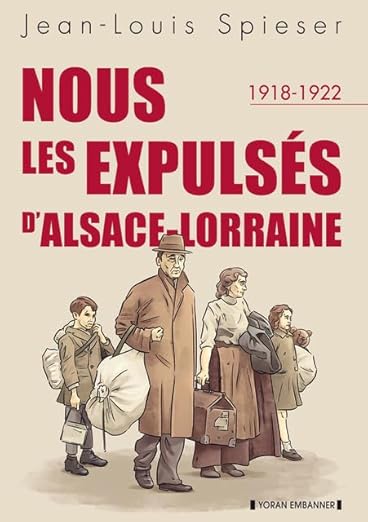
On parle souvent des « optants », ceux et celles qui ont indiqué préférer demeurer Français plutôt que devenir Allemands en 1871-72 : 120 000 Alsaciens et Lorrains ont rempli cette déclaration, et on estime que 50 000 d’entre eux ont effectivement franchi le pas. En 1918-19, le mouvement inverse n’a pas été volontaire : 130 000 Allemands et Alsaciens « germanophiles » ont été expulsés manu militari dès décembre 1918, avec un minimum de bagages, parfois après que leurs commerces ou résidences aient été saccagés ou pillés.
Depuis quelques années, des livres documentent enfin ce nettoyage ethnique, dont Üs unserer Franzosezit/Nos années françaises (Yoran embanner, 2016) de l’écrivaine alsacienne Marie Hart, mariée à un Allemand. Avec Nous les expulsés d’Alsace-Lorraine, Jean-Louis Spieser récapitule ce grand exode du point de vue de ceux qui l’ont subi, en cherchant et traduisant de nombreux témoignages de l’époque, dont certains inédits.
On découvre, dès l’armistice de 1918, les évènements qui s’enchainent. Les petites lâchetés de beaucoup d’Alsaciens, hier encore s’inclinant devant les autorités allemandes, et même de certains Allemands : ils arborent le drapeau français sur leur maison ! La liesse populaire qui entoure l’arrivée des troupes françaises à Strasbourg notamment, liesse nourrie de 4 années de privations et de dictature militaire prussienne tatillonne. La classification de la population en 4 catégories : de « A » pour les « Vieux-Alsaciens » à « D » pour les « Boches », une idée proposée dès 1915 par l’abbé Wetterlé réfugié en France. L’hostilité grandissante contre ces « Boches » et leur expulsion rapide les mois suivants, parfois sous les coups et les huées, en dépit des déclarations officielles sur leurs droits. Inversement, les soldats alsaciens Feldgrauen démobilisés qui veulent rentrer chez eux se voient traités avec suspicion et parfois refoulés à la frontière. Le climat est tel que même le Dr Schweitzer, titulaire d’une carte A mais marié à une Allemande, préfère se mettre à l’abri en Forêt-Noire. Et on lira avec tristesse les commentaires abjects de Hansi ou de son compère francophile l’abbé Wetterlé qui applaudissent cette épuration ethnique. Ces excès, ainsi que la désorganisation économique de 1919-1920, contribuent à retourner l’opinion alsacienne : le fameux « malaise alsacien » des années 1920 trouve là ses racines.
Jean-Louis Spieser ne prétend pas être historien, mais son travail s’en approche grâce à une documentation historique détaillée et bien expliquée. Ce livre copieux, mais facilement lisible, est une solide contribution à notre « devoir de mémoire » d’Alsaciens.
Nos ancêtres Alamans et leurs lois coutumières, Bernard Wittmann, Yoran embanner, 240 pages, 18,50€
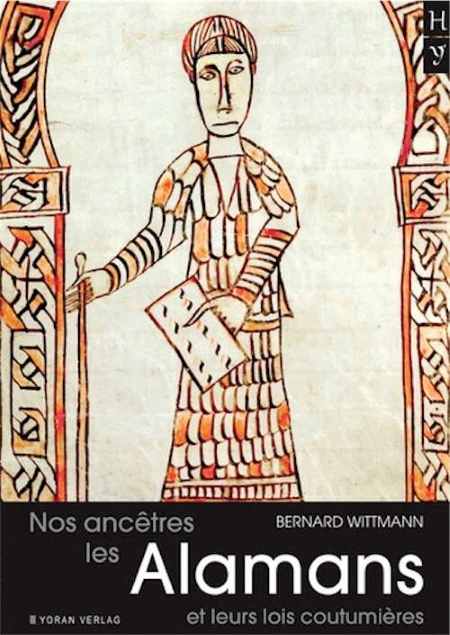
Non, ce livre n’est pas réservé aux juristes ! Après un premier ouvrage Les Alamans dédié à l’histoire de nos ancêtres Alamans depuis l’époque romaine et les grandes invasions (IVème siècle) jusqu’à l’âge d’or des empereurs Hohenstaufen (XIIIème siècle), Bernard Wittmann récidive et nous fait découvrir l’organisation de la société alamane au Moyen-Âge.
Pour cela, il se base sur deux lois parvenues jusqu’à nous : Pactus legis Alamannorum (613-628) et une version ultérieure Lex Alamannorum (712-730). C’est en fait le Code civil de l’époque, hérité du droit coutumier germain. Principe de base : le Wergeld, cad la compensation que verse le coupable à la victime ou à sa famille pour les dédommager. Le but est bien sûr de rompre le cycle infernal de la vengeance et rétablir ainsi l’ordre et la tranquillité intérieure.
Ces textes, comme le Code civil, prévoient une foultitude de cas, des plus graves (meurtre, viol, mise en esclavage) aux moins graves (vol, querelles, travail le dimanche). Et du coup on pénètre à l’intérieur de l’organisation sociale, car tuer un homme libre vaut plus cher que tuer un esclave, etc. Bernard Wittmann nous décrypte cela et fait ainsi revivre en détails cette société du Haut Moyen-Âge où nombre de coutumes tribales des Alamans sont toujours en vigueur. Un voyage dans le temps passionnant.